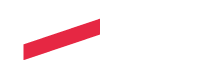- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF
Vous êtes ici :
- Accueil FR ›
- Actualités ›
- Evènements
- Culture scientifique et humanités,
- Recherche,
Soutenance de thèse Vincent Batantou
Publié le 13 décembre 2024
Soutenance de thèse de Vincent Batantou, doctorant du laboratoire CRHEC de la faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines de l’UPEC. La thèse, dirigée par Nathalie Gorochov, s'intitule "De la pénitence à la confession. Avant et après le concile de Latran IV (1215)".

Date(s)
le 14 janvier 2025
à 9h30
Lieu(x)
Résumé de la thèse
L’Eglise primitive, jusqu’à fin IIe siècle, n’exerce pas encore l’autorité de déclarer à ceux qui se repentent l’absolution et la rémission de leurs péchés. La seule pratique pénitentielle qui existe en ce temps est une confession rituelle. Du point de vue sacramentel, au IIe siècle, début de l’ère chrétienne, le sacrement du baptême est le seul et unique sacrement de pardon des péchés. Pourtant, très tôt, la pureté baptismale que l’Eglise primitive veut tant conserver, et qui est en même temps son idéal, se heurte à une réalité : le caractère inévitable du péché.A partir IVe publique, l’Eglise se sait dépositaire d’un pouvoir considérable sur la rémission des péchés ; l’évêque, chef de la communauté, s’impose comme ministre de la pénitence. C’est lui qui en vertu du pouvoir des clés, accorde le pardon de l’Eglise aux fidèles qui ont commis des péchés au grave retentissement. Toutefois, fin VIe siècle, début VIIe siècle, on voit s’introduire dans l’Eglise une nouvelle forme de pénitence : la pénitence dite privée introduite sur le continent par les moines celtiques. Au XIIIe siècle, Latran IV légifère sur la confession qui devient une institution ; le canon 21 définit des nouvelles règles qui devront régir la confession ; tout fidèle parvenu à l’âge de la raison doit se confesser à son propre curé. Les fidèles, précisément ceux qui n’accompliront pas leur devoir, se confesser puis communier à Pâques, encourent des sévères sanctions dont la privation de sépulture après leur mort. Théologiens et canonistes s’emparent du canon 21 de Latran IV ; les premiers tâchent de mettre en place des premières formulations en lien avec cette règle, les canonistes quant à eux, mènent une réflexion approfondie sur les casus.
Cet immense et gigantesque travail théologique et canonique s’insère dans une littérature : les manuels de confesseurs et les sommes de confesseurs. Ils accompagnent la réorganisation du système pénitentiel, éclairent les confesseurs dans cette tâche inhabituelle : l’administration du sacrement de pénitence. L’impulsion à la pastorale pénitentielle est également donnée par les évêques. Ces derniers mettent à la disposition de leurs prêtres des statuts synodaux dans lesquels se trouvent une codification brève et pratique de tout ce qui concerne l’administration du sacrement de pénitence. Après 1215, l’acte de se confesser s’insère facilement dans la vie de chaque fidèle ; il n’empêche que la confession reste pour certains fidèles un exercice difficile. En même temps naissent au sein de l’Eglise de grandes controverses sur la confession.
Membres du Jury
- Nicole Bériou, Institut de France, examinatrice
- Arnaud Fossier, Université de Bourgogne, rapporteur
- Nathalie Gorochov, Université Paris-Est Créteil, directrice de thèse
- Alain Provost, Université d'Artois, examinateur
- Anne Reltgen-Tallon, Université de Picardie-Jules Verne, rapportrice.
- Télécharger en PDF
-
Partager cette page
- Télécharger en PDF